La langue anglaise n'existe pas
« La langue anglaise n’existe pas » ! Cette déclaration péremptoire est le titre du dernier ouvrage de Bernard Cerquiglini, linguiste éminent, qui précise : « C’est du français mal prononcé ».
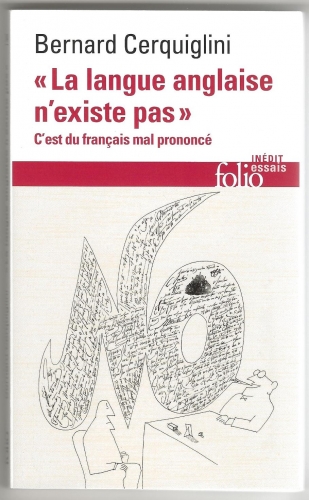
Il a emprunté cette phrase à l’illustre homme politique français Georges Clemenceau (1841-1929), qui ne craignait pas d’ajouter : « L'Angleterre n’est qu’une colonie française qui a mal tourné ».
Dans son essai (Folio, Gallimard, 2024), Cerquiglini accumule les preuves de ce qu’il avance. Il fournit d’ailleurs une statistique sur l’origine du vocabulaire anglais : français 29%, latin 29%, germanique 26%, autres 16%. Donc une majorité « romane ».
Ce qui débuta par l’arrivée des Normands en 1066, une « véritable colonisation, suivie par une période en langue seconde (1260-1400), fut complétée par une ascendance prestigieuse (XVe siècle-1945) », explique l’auteur.
Reprenant la citation de Clemenceau, l’auteur corrige : " il ne s’agit pas d’un français mal prononcé ", mais « articulé autrement, selon des habitudes locales ».
D’innombrables exemples nous expliquent les infimes modifications entre la base française et l’appropriation anglaise. Souvent, il suffit d’un changement de suffixe pour glisser d’une langue à l’autre. Des mots qui en français s’achèvent par « el » deviennent « al » en anglais : annuel-annual, formel-formal. La terminaison française « té » s’écrit « ty » en anglais : beauté-beauty. Voici d’autres exemples : « eur » en « or », comme acteur-actor ; « eur » en « our » : candeur-candour ; « eux » en « ous » : curieux-curious, dangereux-dangerous ; « aire » en « ary » : adversaire-adversary ; « ère » en « ery » : mystère-mystery ; « oire » en « ory » : gloire-glory.
Le passage du français à l’anglais n’est pas toujours aussi régulier. Quand la couronne devient crown, le son est assez proche, mais l’orthographe totalement différente.
A propos de la noblesse, on peut noter que beaucoup de termes ont été repris sans changements ou presque : baron, prince, royal, duke, monarch. Cela remonte à l’origine normande.
Le titre de courtoisie, Esquire, encore utilisé dans la correspondance, est une variante de l’écuyer, le jeune homme portant le bouclier de son seigneur.
Recours au français
Ce que l’on considère aujourd’hui comme un anglicisme n’est parfois qu’un recours au français. L’humour, par exemple, a été emprunté à l’anglais en 1735, mais il n’était qu’une variante de l’humeur en français.
Cerquiglini affirme : « les anglicismes sont des néologismes du français. » Dans le parcours entre les deux langues, voici le flirt, dont le cheminement est charmant. Mais l’auteur nous détrompe, il remplit une très longue note pour annoncer qu’il ne s’agit pas de conter fleurette, que la route est beaucoup plus tortueuse.
Du même acabit, W.C., emprunté en 1887 à water closet, comporte une origine française : closet, cabinet, était en ancien français closet, diminutif de clos, terrain clôturé.
Parmi les curiosités, Cerquiglini rapporte la trouvaille de Walter Scott dans un passage d’Ivanhoé : « Le bœuf s’appelle ox quand il est sous la garde de misérables serfs (…), mais il devient beef lorsqu’il arrive devant les honorables mâchoires destinées à le consommer ». Ainsi pour calf-veal et pig-pork. Le même animal est saxon quand il est dans les champs, puis français quand on le sert à table.
Le vocabulaire anglais s’est enrichi par trois registres. Le concret se fonde sur le saxon, l’abstrait sur le français et le noble sur le latin. Par exemple, le courage a trois expressions : boldness (saxon), courage (français) et fortitude (latin).
Sports
Pour terminer, voyons l’influence du français sur les sports que l’on dit pourtant une invention anglaise. Or le nom dérive quand même de « se desporter », ancien français pour « se divertir ».
Choisissons le tennis – qui me tient particulièrement à cœur - , abréviation du lawn tennis (tennis sur gazon joué dès 1880) ; il dérive du tennis, le jeu de paume français, qui provient de « tenez », que le joueur criait pour avertir qu’il allait servir. S’il réussit un ace, le serveur obtient un point. Or l’ace se base sur l’as français, face du dé marquée d’un point, dérivé de l’as latin, pièce de monnaie. Finalement le joueur remporte le jeu, le set et le match.
P.S. Dans un message antérieur (8 avril 2023) intitulé Francophonie menacée, je mettais l'accent sur l'invasion des anglicismes. Ce texte-ci aborde le problème sous un angle bien différent. Rien n'est jamais statique.